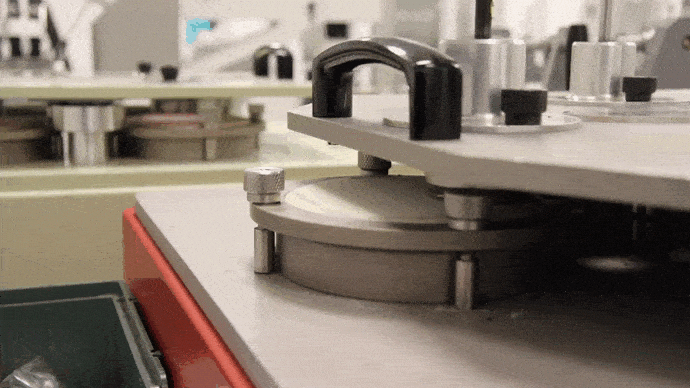Acheter moins de vêtements, c’est bon pour l’économie (à une condition)
Acheter moins de vêtements, c’est bon pour l’économie (à une condition)


Une vidéo créée par l’ADEME (l’agence de l'État pour l’environnement) a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines : on y voit un “dévendeur” décourager un client d’acheter un polo, en lui expliquant que celui qu’il porte est déjà très bien.
Un spot qui a fait scandale à la fois dans le monde de l’entreprise (le MEDEF a demandé son retrait immédiat) et chez certains politiques (Bruno Le Maire l’a jugée “regrettable”). Principale critique : cette pub risquerait de mettre en difficulté les enseignes d’habillement, alors même que le secteur textile traverse une crise et a besoin de faire du chiffre d’affaires en cette période difficile – décembre est un mois crucial pour les commerçants. On lui a aussi reprochée d’être méprisante pour une profession qui s’efforce de faire son métier au mieux : conseiller pour au final, vendre.
Pour nous faire notre propre avis, on a décidé de creuser ce sujet : alors, vendre moins de vêtements, c’est mauvais pour les commerces de vêtements ? Réponse courte : non, si on relocalise la production en France ou en Europe. Réponse longue : notre article ci-dessous.
1. On n’a jamais acheté autant de vêtements
Avant d’entrer dans le vif du sujet, rappelons quelques ordres de grandeur sur combien d'habits neufs sont achetés chaque année. En France, sans même prendre en compte le linge de maison et les chaussures, 2,7 milliards de vêtements ont été mis sur le marché en 20221. C’est plus que de boîtes de six œufs.

Si on enlève les invendus2, chaque Français achète donc en moyenne 40 vêtements neufs chaque année3. C’est beaucoup : dans les années 80, c’était environ deux fois moins4. Est-ce que les gens étaient mal habillés pour autant ? On vous laisse juger, mais ils avaient quand même quelque chose à se mettre sur le dos.

2. Pour la planète, il faut acheter moins
Un niveau de consommation de vêtements aussi massif n’est pas sans conséquences écologiques. On les a déjà décrites dans plusieurs articles : émissions de gaz à effet de serre, destruction de la biodiversité, microplastiques… Si vous n’avez pas le temps de les lire, retenez une chose : produire, c’est polluer.
Est-ce qu’on pourrait diminuer ces pollutions significativement et rapidement, tout en maintenant les mêmes volumes de consommation, en comptant sur les innovations techniques ? C’est assez improbable :
- Les ordres de grandeur de réduction permises par les innovations techniques sont trop faibles. Par exemple, si on regarde le “recyclage”, souvent brandi par les marques comme solution ultime, il ne permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’eau du secteur textile que de 5 ou 6%, même au prix de gigantesques efforts5.
- Ces innovations techniques ne se déploient pas assez rapidement. Par exemple, beaucoup de marques ont pour ambition de “décarboner” leurs usines, c'est-à-dire de les faire tourner aux énergies vertes plutôt qu'au gaz, au charbon ou au pétrole… C’est une super intention, mais si on regarde le Bangladesh (2e pays fournisseur d’habillement de la France après la Chine), la part d’énergies renouvelables dans la production d’électricité est insignifiante et ne progresse quasiment pas (on vous renvoie vers cet article si vous voulez creuser le sujet de la réduction des émissions de CO2 dans le textile).

Certaines innovations techniques peuvent être utiles, mais elles peuvent aussi agir comme un écran de fumée qui nous empêche de voir l’éléphant de la pièce : produire, c’est polluer (bis). Alors le moyen le plus efficace et le plus rapide pour réduire la pollution de la mode, c’est bien de produire moins de vêtements.
Mais ce que l’avalanche de réactions face à la pub sur ces “dévendeurs” laisse penser, c’est que même si acheter moins de vêtements serait nécessaire d’un point de vue écologique, ce serait une catastrophe d’un point de vue économique. On risquerait de précipiter la chute de centaines d’entreprises d’habillement qui mettraient la clé sous la porte. Autrement dit, cette pub réveille une sorte de nouveau débat “fin du monde vs. fin du mois” mais appliqué aux entreprises.
Alors est-ce vraiment le cas ? Est-ce qu’acheter moins de vêtements provoquerait forcément un désastre économique ?
3. Pour l’économie, il faut acheter moins et fabriquer plus localement
Avant de parler de la santé économique des entreprises d’habillement, regardons d’abord celle du pays dans son ensemble.
Les risques de la surconsommation pour l’économie française
Comme la plupart des usines textiles sont en Asie, dès qu’on achète un vêtement, c’est de l’argent qui quitte la France.

En 2021, avec plus de 12 milliards d’euros de déficit, le textile était notre 3e industrie la plus déficitaire, responsable à elle seule de plus de 20% du déficit global hors énergie6. Et les déficits commerciaux abyssaux de la France ont des conséquences. Pour les payer, on doit s’endetter auprès des pays étrangers. Plus d’explications dans ce rapport, mais si on devait le dire (très) simplement, c’est comme si on empruntait de l’argent à la banque pour aller manger tous les jours au resto au lieu de cuisiner à la maison.
Attention, ce n’est pas forcément mal de s’endetter : ça peut se comprendre si c’est pour acheter des métaux rares pour investir dans la transition énergétique, ou des machines pour relocaliser notre industrie pharmaceutique. Mais si c’est pour faire venir des milliards de vêtements low-cost, ça revient juste à vivre au-dessus de nos moyens. Et ça ne pourra pas durer éternellement7. Alors tous ces vêtements importés de l’étranger, c’est autant d’argent qu’on ne pourra pas investir dans des biens vraiment utiles à notre économie.
Et puis on pourrait évoquer le manque-à-gagner pour les recettes fiscales du pays avec toutes ces usines délocalisées à l’étranger. Moins d’entreprises en France, c’est moins d’impôts collectés et au final moins d’argent pour financer les écoles ou les hôpitaux.
Bref, cette surconsommation de vêtements importés est risquée pour l’économie française dans son ensemble. Mais si on regarde le secteur de l’habillement, est-ce qu’une plus grande sobriété ne mettrait pas en péril les enseignes déjà en difficulté ?
Le problème du textile français, ce n’est pas la sobriété, c’est le low cost
Oui, 2022 et 2023 ont été catastrophiques pour certaines marques françaises. Vous vous souvenez peut-être des faillites de Camaïeu, Kookaï, San Marina, Jennyfer ou encore Pimkie… C’est clairement une période très difficile à traverser.
Mais quelles en sont les causes ? Est-ce que c’est parce que les Français se sont mis globalement à acheter beaucoup moins de vêtements à cause de l’inflation et d’une baisse du pouvoir d’achat ?
Cela ne semble pas vraiment être le cas : pour 2023, on n’a pas encore les chiffres officiels, mais en 2022, le nombre de vêtements produits a continué à progresser (+2%8). Et ce qu’on peut observer, c’est que certaines marques se portent plutôt bien. Kiabi a fait +10% de chiffre d’affaires en 2022 et les enseignes de fast fashion étrangères battent tous les records, à l’image d’Uniqlo, H&M, Zara ou Primark9. Il faut bien sûr y ajouter les nouveaux venus de l’ultra fast fashion comme Shein ou Temu.
En d’autres termes, la cause des déboires de ces enseignes, ce n’est pas la sobriété de consommation textile des Français : c’est plutôt un report de la consommation vers les enseignes low cost à cause de l’inflation10. D’ailleurs, ce sont bien les enseignes à bas prix qui captent aujourd’hui l’essentiel de la consommation textile française : 7 vêtements sur 10 vendus en France sont désormais du low cost11. Et c’est frappant quand on regarde le top 10 des marques qui vendent le plus en France :

Ok, mais même si le marché est dominé par ces enseignes low cost, qu’elles soient françaises ou étrangères, ça doit représenter quand même plein d’emplois dans le commerce non ? Si dans les années à venir, les Français se mettaient vraiment à acheter moins de vêtements, est-ce qu’il n’y aurait pas un risque de créer du chômage ?
Rien n’est moins sûr. Sur les 50 dernières années, la hausse très rapide du nombre de vêtements vendus n’a pas créé d’emplois chez les enseignes d’habillement, au contraire.
Entre 1971 et aujourd’hui, alors que le volume de consommation de vêtements a plus que doublé, 30 000 emplois ont été détruits dans le commerce de détail d’habillement13. Jamais on a consommé autant de vêtements, jamais on a eu aussi peu d’emplois dans le commerce. La faute des ventes en ligne ? En partie, mais pas tant que ça. Si on regarde les chiffres, les emplois du commerce textile avaient déjà largement diminué avant l’arrivée massive d’internet14.
Le principal responsable de la baisse des emplois dans le commerce d’habillement en France, en réalité, c’est le low cost. Les prix relatifs des vêtements (comparés aux revenus) ont été divisés par deux en 30 ans. Donc les commerçants ont beau vendre plus de vêtements, ils n’en tirent pas de meilleurs revenus pour autant15. Schématiquement, la vente de vêtements permettait à l’époque de faire vivre beaucoup de petits commerces ; aujourd’hui, les vêtements à bas prix sont vendus dans des plus grandes surfaces qui vendent beaucoup en quantité mais avec moins de personnel.
Et puis il n'y a pas que chez les commerçants que le low cost a fait disparaître de l'emploi, il en a aussi détruit énormément ailleurs dans le textile :
- Dans les usines : comme ces vêtements sont de moins en moins fabriqués en France, le nombre d’emplois de l’industrie textile a été divisé par trois en 30 ans16.
- Dans les ateliers de retouche-couture et les cordonneries : comme les Français achètent désormais beaucoup plus de vêtements neufs, ils font moins réparer les leurs. Pour vous donner une idée, le nombre de cordonniers est passé en France de 45 000 dans les années 5017… à seulement 3500 aujourd’hui18.
- Et puis il y a tous les emplois indirects détruits dans les bassins textiles : quand une usine ferme, c'est aussi la boulangerie, le café, la banque ou la Poste qui ferment. Dans les bassins industriels textiles sinistrés comme le Nord, l’Aube ou les Vosges, le taux de chômage reste bien plus élevé que dans le reste de la France19.

***** Parenthèse *****
Oui, mais les enseignes low cost, c’est bien : ça permet d’habiller les classes défavorisées, non ?
Oui, mais non. Certes, les vêtements à bas prix donnent du pouvoir d’achat et permettent à certains Français en difficulté de s'acheter plus facilement des vêtements neufs. Mais si on prend du recul, on se rend compte que c'est un cadeau empoisonné :
Les classes populaires sont les premières victimes du low cost : les délocalisations de l’industrie textile depuis les années 80 ont détruit énormément d’emplois, comme expliqué plus haut. Une partie de ces ex-emplois industriels (pour produire nos vêtements sur place) se sont transformés en emplois dans la logistique et le transport (pour importer nos vêtements de l’étranger), mais ils sont moins nombreux, plus précaires et moins bien payés.
Les prix des vêtements sont tellement dérisoires et les pressions à la consommation tellement puissantes (renouvellement des collections, promotions…) que même les personnes issues des classes défavorisées peuvent acheter plus que ce qu'elles avaient prévu dans leur budget (à l’image de cette dame dans ce reportage “souvent à l’euro près”).
Les délocalisations créent un manque-à-gagner pour les recettes fiscales du pays avec toutes ces usines délocalisées à l’étranger. Moins d’entreprises en France, c’est moins d’impôts collectés et au final moins d’argent pour financer l’éducation ou la santé. Or le service public, c’est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas.
Les classes défavorisées sont les premières à souffrir des conséquences à long terme de la surconsommation, en particulier celles du changement climatique
La majorité des ventes du low cost ne sont pas le fait des personnes les plus défavorisées : si 7 vêtements sur 10 vendus en France sont des vêtements à bas prix, c’est que la clientèle des enseignes low cost dépasse largement les classes les plus pauvres. L’argument de soutenir des modèles low cost en leur nom est donc sérieusement biaisé.
***** Fin de la parenthèse *****
Si on relocalise l’industrie, on peut avoir de la sobriété et des entreprises en bonne santé
Pour re-créer de la richesse et des emplois dans le textile, il faut donc refaire… comme avant : fabriquer moins de vêtements, mais fabriquer des vêtements plus localement, en France ou en Europe.
Cela créerait des emplois :
- Dans les usines : pour vous donner une idée, l’industrie textile en Italie c’est encore 464.000 emplois vs. seulement 105.000 en France21.
- Dans les commerces d’habillement puisque des vêtements à plus haute valeur permettraient de mieux rémunérer les commerçants ;
- Dans les ateliers de retouche-couture et les cordonneries : moins de vêtements neufs, c’est plus de vêtements réparés ;
- Sans oublier les emplois indirects : si une usine s’implante, ça fait du boulot pour les autres usines de l'écosystème et pour les commerces locaux22.
Et puis accessoirement, cela permettrait de ne pas détruire notre planète et de ne pas fabriquer des vêtements au bout du monde dans des conditions indignes. Rappelons qu’en termes de pouvoir d’achat, travailler au Bangladesh dans le textile, ce serait comme travailler en France plus de 60 heures par semaine23 pour gagner environ 391€ par mois24 (même en prenant en compte les récentes augmentations liées aux manifestations massives dans le pays). Comment vivre dignement dans ces conditions ?
On peut comprendre que cette vidéo ait dérangé une partie des commerçants de l'habillement, qui se sont dits qu’à court terme, un message de sobriété pouvait les faire souffrir encore plus. Mais il ne faut pas se tromper d'ennemi : le vrai danger pour le secteur textile, ce n'est pas la sobriété, c'est le low cost. Les prix dérisoires pratiqués dans la mode mettent en péril notre environnement et empêchent de rémunérer convenablement les fabricants et les commerçants. La sobriété, en revanche, peut être porteuse d'espoir, si cet “acheter moins” s’accompagne d’un “acheter mieux” – avec des vêtements fabriqués plus localement, vendus à des prix forcément plus élevés mais offrant une rémunération digne pour tout le monde.
Ce que l'on peut reprocher au gouvernement au sujet de cette vidéo, c’est de s’être arrêté à une campagne de communication pour sensibiliser le grand public, alors qu’il faudrait traiter le problème à la racine avec des lois qui favorisent la sobriété et la relocalisation. Exemple : pénaliser les marques de fast fashion qui fabriquent des vêtements en versant des salaires de misère et poussent les clients à acheter toujours plus (ce qu’on demande avec de nombreuses autres marques textiles via le mouvement En Mode Climat).
Au final, ce que révèle la levée de boucliers autour de cette vidéo qui prône la sobriété, c’est qu’on pense qu’il y a forcément un antagonisme entre “sobriété” et “prospérité”. Mais l’exemple du textile montre que cette opposition n’est pas basée sur une réalité chiffrée : si on relocalise la production, on peut conjuguer les deux.
Enfin, à trop fermer les yeux sur les conséquences écologiques de leur production, les entreprises scient la branche sur laquelle elles sont assises : sur le long terme, elles auront besoin d’énergie pour faire tourner les machines, de ressources pour les alimenter, de personnes en bonne santé pour y travailler… bref des conditions préalables que la crise écologique détruit petit à petit. L’économie n’est pas hors-sol : il n’y aura jamais d’entreprises en bonne santé sur une planète brûlée.
Pour aller plus loin :
- Lire l’excellent livre La Sobriété Gagnante de Benjamin Brice, qui montre que la sobriété ne doit pas être vue comme une contrainte mais comme une chance pour notre économie. Si elle est associée à une politique ambitieuse de relocalisation d’activités industrielles, elle peut nous permettre de réduire à la fois notre empreinte environnementale, nos déficits et nos inégalités sociales.
- Regarder ce débat auquel on a participé et qui reprend l'essentiel des arguments de l'article.
Qui on est pour dire ça ?
Vous êtes sur La Mode à l’Envers, un blog tenu par la marque de vêtements Loom. L'industrie textile file un mauvais coton et c'est la planète qui paye les pots cassés. Alors tout ce qu’on comprend sur le secteur, on essaye de vous l’expliquer ici. Parce que fabriquer des vêtements durables, c’est bien, mais dévoiler, partager ou inspirer, c’est encore plus puissant.
On ne fait jamais de pub : si vous aimez ce qu'on écrit et que vous en voulez encore, abonnez-vous à notre newsletter en cliquant ici. Promis, on vous écrira maximum une fois par mois.
Notes
1 Source : Rapport d’activité Refashion 2022.
2 3,3 milliards * 83% de vêtements / 67,8 millions d’habitants * 99% = 40 vêtements / habitant. Il n’y a que 1% d’invendus dans le textile. Cf. rapport Ademe 2021 : “Etude des gisements et des causes des invendus non alimentaires et de leurs voies d’écoulement” : les invendus bruts représentent 4,1% du chiffre d’affaires du secteur des vêtements et chaussures. 65% de ces invendus sont ensuite revendus à des déstockeurs, 20% sont donnés à des associations, 10% sont recyclés-réparés, 5% sont détruits. Donc sur ces vêtements déclarés comme “invendus”, on peut considérer qu’un maximum de 20% vont être détruits ou “décyclés” (si on considère qu’une partie des dons aux associations finissent ainsi). Au final, les invendus détruits représentent donc moins de 1% des ventes (20% x 4,1% = 0,8%).
3 Si on ajoute les chaussures et le linge de maison, on est à presque 50 pièces textiles par Français.
4 En 1984, la consommation de vêtements était de 1,3 milliards en France, donc 23 vêtements / habitant / Français. Source : Enquête INSEE 1984 sur 7500 ménages.
5 Etude Quantis Measuring Fashion 2018 : si on atteint 40% de fibres recyclées, on émettrait 5,9% d’émissions de GES en moins et on consommerait 4,5% d’eau en moins.
6 Source.
7 La position extérieure nette de la France (l’endettement de la France vis-à-vis du reste du monde) est de -800 Mds €, soit 32% du PIB. La France se rapproche du plafond fixé par les accords européens qui est de 35% du PIB. C’est seulement une convention : en soi, ce ne serait pas grave de le dépasser, mais cela montre qu’il y a des limites à ne pas franchir pour avoir une économie en bonne santé. À noter qu’au début des années 2000, la France était encore créancière nette (donc avec une position extérieure nette positive). Source.
8 Source : Rapport d’activité Refashion 2022.
9 On ne connaît pas le détail de leurs chiffres sur le marché français, mais il n’y a pas de raisons pour qu'ils ne soient pas aussi en croissance.
10 Certains experts évoquent également le fait que ces marques ont raté le virage technologique ou n’ont pas investi assez dans leur “branding”. Cela peut jouer aussi mais sans doute moins que le report de la consommation vers des prix moins élevés en cette période d’inflation. Et si l'on prend l'exemple Leclerc, n'être pas particulièrement performant sur le branding ou l'e-commerce ne l'empèche pas d'être le second vendeur de vêtements en France...
11 Source : Etude Kantar Refashion novembre 2022.
12 Source : panel Kantar (12 500 personnes).
13 Sources INSEE en ETP salariés + non salariés. Pour 1971, on se base sur l’enquête annuelle d’entreprise, qui estime ce nombre à 161 000 dans l’habillement et 32 620 dans les chaussures. Pour les emplois actuels, on se base sur l’enquête points de vente 2009, qui estime ce nombre à 134 608 dans habillement et 27 914 dans les chaussures.
14 L’étude points de vente de l’INSEE qui montre la destruction des emplois dans le commerce date de 2009, alors que la part du e-commerce d’habillement était encore limitée. On pourrait aussi accuser les grandes surfaces alimentaires d’avoir détruit des emplois dans le commerce de détail d’habillement, mais elles ne représentent pas une si grosse part des ventes d’habillement : en 2011, 17% des ventes d’habillement étaient faits en grande surface, selon l’INSEE.
15 Depuis 30 ans, les prix des vêtements sont restés plutôt stables dans l’absolu (entre 1990 et 2020, les prix de l’habillement n’ont augmenté que de 15% selon l’INSEE), mais les revenus moyens des Français ont plus que doublé (hausse des revenus arbitrables bruts par Français entre 1990 et 2020 : +92% selon l’INSEE, source). Donc si un commerçant veut atteindre un niveau de revenu comparable à celui d’il y a 30 ans, il doit vendre presque deux fois plus de vêtements.
16 Le nombre d’emplois dans l’industrie textile, dont cuir et chaussures, a été divisé par trois entre 30 ans, passant de 325 000 à 100 000 emplois en 30 ans. Source INSEE : L’industrie textile en France : une production mondialisée, sauf pour les produits de luxe et les textiles techniques.
17 Source : Sociologue R. Shapiro, Cordonnier Profil Métier 1991.
18 3 462 entreprises recensées au RNM avec le code d’activité 95.23Z, étude Ademe 2022 “Fonds réemploi réutilisation réparation de la filière TLC”, si on estime qu’il y a un emploi par structure.
19 Taux de chômage 3e trimestre 2021 selon l'INSEE : 10,0% dans le Nord, 10,2% dans l’Aube, 8,5% dans les Vosges vs. 7,9% en France métropolitaine.
20 Source INSEE 2020 : 29,7% de chômage chez les 15-64 ans à Roubaix. Et avec la fermeture de Camaïeu qui avait son siège à Roubaix, le sort s’acharne sur la ville, plus que jamais victime du textile low cost.
21 Source Eurostat.
22 Il est généralement admis qu’un emploi industriel permet de générer deux à trois emplois indirects chez d’autres acteurs industriels, et des emplois induits dans le reste du bassin d’emploi dans les activités de service et les commerces. Source : Anaïs Voy-Gillis, spécialiste en réindustrialisation.
23 L’initiative Garment Workers Diaries rapporte qu’entre décembre 2021 et décembre 2022, les couturières bangladaises ont effectué en moyenne 248 heures de travail par mois, soit 62 heures par semaine (source).
24 Le salaire au Bangladesh vient de passer à 12500 takas après les manifestations récentes. Or selon Asian Floor Wage, le salaire vital est à 53104 takas, donc le salaire minimum actuel est de 24% du salaire vital. Comme le salaire de subsistance pour la France est de 1630 euros (source), c’est comme si quelqu’un était payé en France 391 euros par mois. Source : Clean Clothes Campaign.


































































.gif)